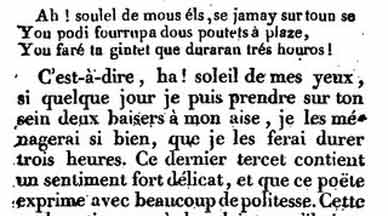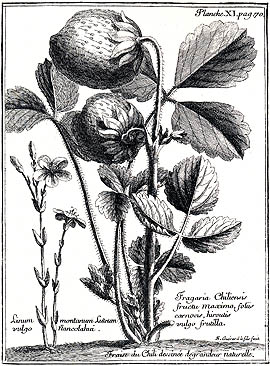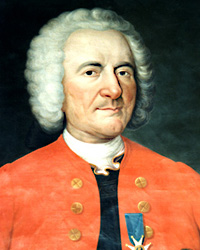Posté par
Robert Geuljans le 26 Déc 2013 dans
f |
0 commentsPlusieurs visiteurs ont eu la gentillesse de m’envoyer la fable LA CIGALE ET LA FOURMI façon provençale !!! écrite par Caldi Richard . Je crois qu’elle voyage librement sur le web. Une excellente occasion pour moi de m’en servir pour illustrer la notion de français régional.
Mode d’emploi :
gras rouge = lien vers l’article dans mon site.
gras bleu = note en bas de page.
gras marron = lien vers le Trésor de la langue française TLF.
CIGALE ET LA FOURMI façon provençale ! par Caldi Richard
Zézette, une cagole de l’Estaque, qui n’a que des cacarinettes dans la tête, passe le plus clair de son temps à se radasser la mounine au soleil ou à frotter avec les càcous du quartier.
Ce soir-là, revenant du
baletti où elle avait passé la soirée avec Dédou, son
béguin, elle rentre chez elle avec un petit creux qui lui agace l’estomac.
Sans doute que la soirée passée avec son frotadou lui a ouvert l’appétit, et ce n’est certainement pas le petit chichi qu’il lui a offert, qui a réussi à rassasier la poufiasse. Alors, à peine entrée dans sa cuisine, elle se dirige vers le réfrigérateur et se jette sur la poignée comme un gobi sur l’hameçon.
Là, elle se prend l‘estoumagade de sa vie.
Elle s’écrie :
– » Putain la cagade! y reste pas un rataillon, il est vide ce counas.
En effet, le frigo est vide, aussi vide qu’une coquille de moule qui a croisé une favouille. Pas la moindre miette de tambouille.
Toute estransinée par ce putain de sort qui vient, comme un boucan, de s’abattre sur elle, Zézette résignée se dit :
– » Tè vé, ce soir pour la gamelle, c’est macari, on va manger à dache « .
C’est alors qu’une idée vient germer dans son teston.
– » Et si j’allais voir Fanny ! se dit-elle.
– » En la broumégeant un peu je pourrai sans doute lui resquiller un fond de daube « .
Fanny c’est sa voisine. Une pitchounette brave et travailleuse qui n’a pas peur de se lever le maffre
Aussi chez elle, il y a toujours un
tian qui mijote avec une soupe au
pistou ou quelques
artichauts à la barigoule.
Zézette lui rend visite.
– » Bonsoir ma belle, coumé sian ! Dis-moi, comme je suis un peu à la
dèche en ce moment, tu pourrais pas me dépanner d’un
péton de nourriture ! Brave comme tu es, je suis sûre que tu vas pas me laisser dans la
mouscaille.
En effet, Fanny est une brave petite toujours prête à rendre service.
Mais si elle est brave la Fanny elle est aussi un peu rascous (=
rascas « teigneux »?) et surtout elle aime pas qu’on vienne lui
esquicher les
agassins quand elle est en train de se taper une grosse
bugade; ça c’est le genre de chose qui aurait plutôt tendance à lui donner les
brègues.
Alors elle regarde Zézette la
manjiapan et lui lance:
– » Oh collègue ! Tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin ? Moi !!!, tous les jours je me lève un
tafanari comaco pour me nourrir ! et toi pendant ce temps là, qu’est-ce que tu fais de tes journées?
– » Moi !!???? « , lui répond la
cagole
– » J’aime bien aller m’allonger au soleil ! ça me donne de belles couleurs et ça m’évite de mettre du trompe couillon. »
– » Ah ! Tu aimes bien faire la dame et te
radasser la
pachole au soleil, et bien maintenant tu peux te chasper.
– » Non mais ???!!!! , qu’es’aco ? C’est pas la peine d’essayer de me
roustir parce que c’est pas chez moi que tu auras quelque chose à
rousiguer, alors tu me
pompes pas l’air, tu
t’esbignes et tu vas te faire une soupe de fèves.
Texte de Caldi Richard
_________________________________________