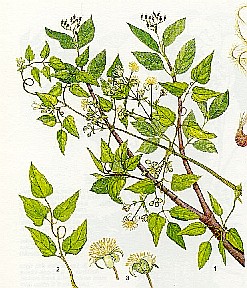Posté par
Robert Geuljans le 5 Août 2011 dans
v |
0 commentsVisetta ou Vizette « escalier tournant extérieur ». Tiré du Compoix de Valleraugue(1625) :
«Maison de Sire Adam CARLE, maison à deux membres en partie crotte 23 cannes 1 pan compris vizette » (tome 1 page 150).(Crotte est une cave voûtée, sur laquelle on trouve à l’étage l’habitation).
L’origine est le latin vitis ‘vigne, sarment, pampre’, plus le suffixe diminutif -itta. Latin vitis est encore vivant dans presque toutes les langues romanes, italien vite, espagnol vid, portugais vide, mais a été remplacé par vinea ‘vigne’ dans une grande partie du galloroman. Vitis a survecu tel quel en rouergat abit ‘cep de vigne’; Millau obise ‘pampre’; au figuré dans l’Aveyron bit ‘cordon ombilical’.
Principalement dans le domaine occitan des dérivés désignent la ‘clématite’, dans le Gard c’est vissano, avissano et rabisano, parce que comme la vigne elle fait deux lianes qui montent en s’enroulant systématiquement à la recherche du moindre support.


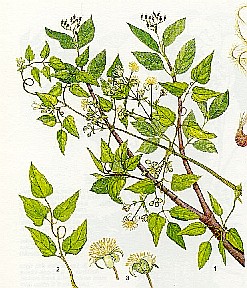
sarment escalier à vis clématite
Partout la vis est la pièce de métal. Limité au galloroman est le sens ‘escalier tournant’, vis en ancien français comme en ancien occitan. Dans les dictionnaires de 1567 jusqu’à Trévoux 1771, la vis saint Gilles est un « escalier qui monte en rampe et dont les marches semblent porter en l’air » d’après le fameux escalier de St Gilles (Gard), appelé ensuite vis saint Gilles, jusqu’au grand Larousse de 1867 qui écrit : « Escalier à vis dont les marches, soutenues par des voûtes d’une coupe particulière, semblent être suspendues dans les airs. Il en existe un modèle célèbre dans le prieuré de Saint-Gilles, en Languedoc. »


« C’est dans l’épaisseur du mur nord de l’ ancien choeur que se trouve la vis. Il s’agit d’un escalier hélicoïdal, datant du XIIème siècle.Il porte une voûte annulaire appareillée à 9 claveaux. Cet assemblage s’appuie sur le noyau central et les murs intérieurement cylindriques, et l’art du tailleur de pierre apparaît dans la double concavité et convexité de chaque voussoir. Elle a été très tôt une oeuvre célèbre, étape des Compagnons Tailleurs de pierre qui vinrent graver leur surnom ou leur devise lors de leur passage. »texte et les 2 photos tirés du site http://perso.orange.fr/erwan.levourch/stereotomie.htm
 Photo que j’ai prise en haut de la vis et qui montre bien la structure et le travail des tailleurs de pierre.
Photo que j’ai prise en haut de la vis et qui montre bien la structure et le travail des tailleurs de pierre.
Le diminutif viseta, vizeta ‘escalier tournant’ attesté depuis le XVe siècle est limité au provençal et l’est-languedocien. L’attestation du Compoix est intéressante pour la précision de la définition « extérieur » : la langue s’adapte à l’environnement!

vizette cévenole
Quand j’ai acheté un masà Valleraugue en 1979, il n’y avait pas d’escalier entre le rez-de-chaussée et l’étage et comme estranger ignorant j’ai installé la cuisine/ salle à manger au rez-de-chaussée, dans la crotte , pour la déménager vers l’étage quelques années plus tard.


anglais vise neerlandais vijzel d’un moulin