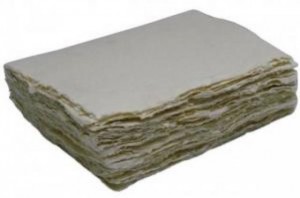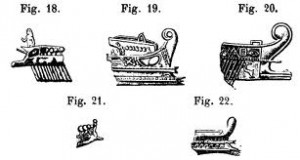Patoc, patot
Patoc « tas, meule de foin ». D’après Alibert le sens de patoc est « tas, amas; meule de foin; grosse brique pour bâtir. (Quercy). Dans le parler de la région d’Agen « brassée, paquet ». D’après le FEW patok, patot signifie »petit tas de foin dans le pré ». Il est bien attesté dans tout le Sud-Ouest, y compris la Saintonge. En ancien gascon patoch a même pris le sens « mesure agraire » = « ce qu’il faut pour faire une meule de foin ». Dans le Gers et ailleurs il y a le verbe empatoucà « mettre le foin en veillotes ».
Le FEW considère patoc « tas de foin » comme un dérivé de patt « patte, griffe ». Il explique que la forme d »un petit tas de foin dans un pré ressemble à une grosse patte surtout quand il a plu. Je ne suis pas convaincu que cette étymologie soit la bonne. L’auteur écrit qu’il ne peut pas s’agir une variante avec métathèse de pacot « paquet » qui en latin médiéval est attesté en Gascogne sous la forme paccotus.
J’ai cherché cette attestation de paccotus sans la trouver. Par contre dans le Ducange j’ai trouvé un paccotus feni « meule de foin ». 1.
Si paccotus, une latinisation de pacot, peut signifier « meule de foin dans le pré », il n’est pas improbable que patoc et pacot aient la même étymologie à savoir le néerlandais pak « ballot » qui a donné paquet en galloroman. Il reste un doute à cause de la date du texte latin ci-dessus, que je ne connais pas.
Il est possible que paccotus a subi l’influence de natot pour devenir patoc et même patot. Mais natot « meule de foin » n’est attesté qu’une seule fois en ancien gascon. (FEW VI/1,507a *matta « touffe »).
_____________________
- MEDALHO, natot, paccotus. Gall. Botte, amas, tas, meule de foin : Et de iii. libris receptis ex pretio trium Medalhonum feni….. ex pretio ii. Medalhonum sive natots feni venditorum in pratio, t. 21, p. 10…. fecerunt acervum seu Medalhonem de dicto feno, t. 22, p. 374……. Emi a priore Sancti-Jacobi xxii. paccotos feni recepti in capite sui prati….. t. 22, p. 373.(Arch. histor. de la Gironde.) ↩