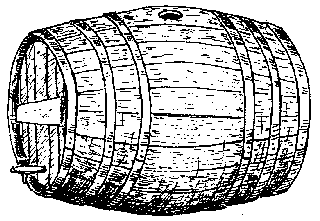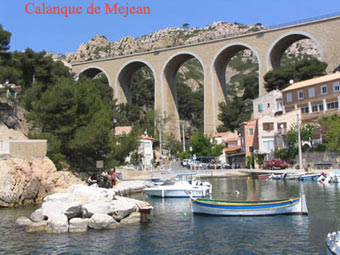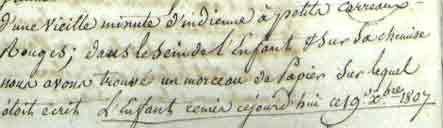Posté par
Robert Geuljans le 29 Août 2012 dans
m |
2 commentsMiougrano « grenade fruit », vient du latin mille « 1000 » + granum « grain ». Attesté déjà en ancien occitan: milgrano.
D’après les données du FEW miougrano était courant dans tout le domaine occitan, mais le Thesoc ne l’a enregistré que dans les dép. ALPES-MARITIMES, ARIEGE, GERS, GIRONDE, HAUTE-GARONNE, LANDES, LOT-ET-GARONNE, PYRENEES-ATL. , et le TARN-ET-GARONNE.
Dans le Sud-ouest GERS, GIRONDE,HAUTE-GARONNE, LANDES, LOT-ET-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES. c’est le type grenada qui l’a supplanté.

L’abbé de Sauvages écrit dans son article Miougragnié « grenadier »:
Les pépins de la grenade sont raffraîchissants , son écorce et les balaustes sont très astringeans & absorbans, on les préfère à la noix de galle pour les teintures en noir de la soie.
Étonné par cette dernière remarque, j’ai trouvé qu’en moyen français migraine désigne aussi « Étoffe teinte en écarlate » (DMF). J’aurai besoin de l’assistance d’un professionnel de la teinture des tissus à l’aide de produits naturels, pour comprendre le « noir de la soie ». Toutes les autres attestations parlent d‘écarlate.
La forme provençale migrano devenue migraine « écarlat » a été prêtée au français du XVe au XVIIIe siècle , mais c’est pomme grenade > grenade, qui a gagné la place en français moderne.L’étymologie de migraine « écarlate » n’est pas la même que celle de miougrano. Le mot grana signifie « teinture d’écarlate provenant de la cochenille », migraine est une demie teinture, ce qui ressort de la forme en ancien béarnais mieye-grane, où mieye vient du latin medius « qui est au milieu ». FEW IV, 237a : granum
Commentaires des visiteurs:
Marjory Salles m’écrit :
Bonjour,
Teinturier de mon état, je serai ravie de vous apporter des précisions concernant la teinture du noir… L’écorce de grenade est très riche en tanin. Et c’est la réaction du tanin avec le fer qui forme un noir très solide. Pour la teinture textile, il s’agit de baigner le tissu dans un bain riche en tanin (décoction d’écorces). Ensuite, en passant ce tissu « tanné » dans une solution riche en fer, la couleur brune du tanin vire au noir.
C’est la même réaction qui est à l’œuvre dans l’encre noire tannique ou dans la production de bogolan africain !
________________________________________________


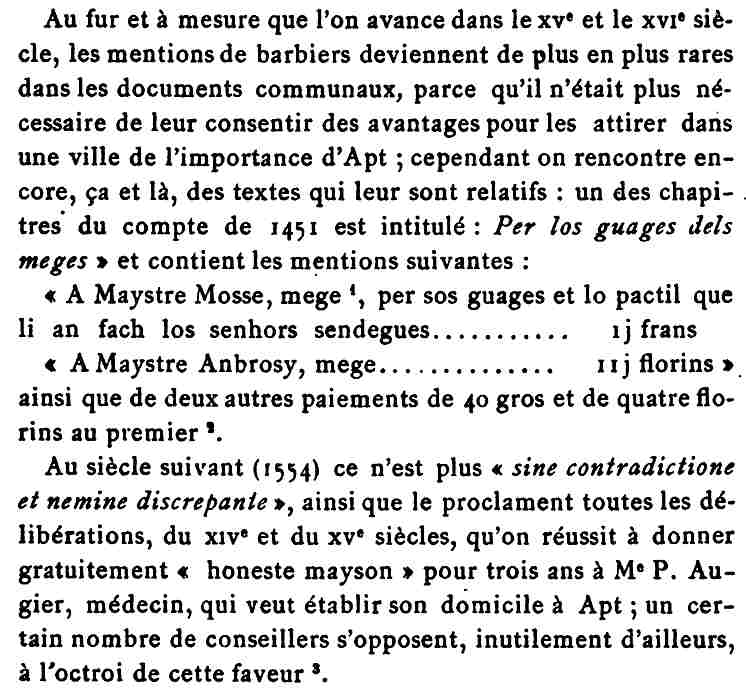
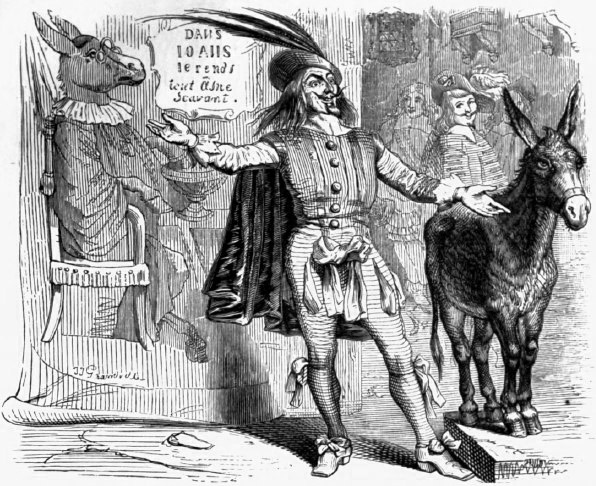

 aubépine
aubépine 

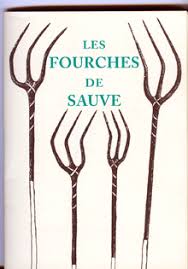

 un vrai demi de 0,5 l
un vrai demi de 0,5 l