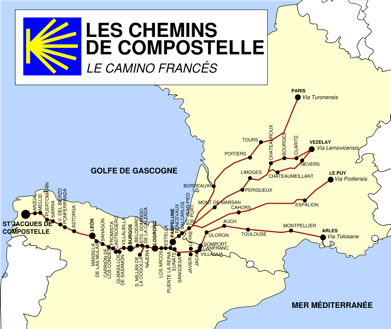Rousto
Rousto ‘volée de coups’, rouste en français régional, roustá « rosser » (Gard).
les Romains qui habitaient le Gard connaissaient très probablement le mot rustum qu’ils prononcaient à peu près comme en languedocien moderne rousto, mais à cette époque un rustum était ‘une tige, un rameau’. Pour des raisons éducatives ils s’en servaient pour roustár « rosser » leur progéniture. De là, les créations languedociennes roustoun, roustoù « testicules; rustre, homme grossier » devenu roustons en argot parisien., vulgaire ou populaire d’après le TLF.
Mistral semble avoir expliqué cette évolution sémantique « tige, rameau » > « testicules » : « parce qu’ils servent à battre » d’après une note dans le FEW, mais je ne l’ai pas retrouvée dans le Trésor. Le FEW l’a repris dans les ‘Incognita’ où il ajoute des formes franco-provençales de la Suisse romande comme risto ‘testicules des béliers’.
Le passage des mots qui désignent les « génitaux » à la notion « rustre, imbécile » etc.etc. ne pose aucun problème; cf. français con, couillon et anglais fuck, néerlandais lul « pénis; imbécile », etc.
 Une célèbre rouste
Une célèbre rouste
Le même étymon a donné en ancien fançais roissier « battre violemment » remplacé depuis par rosser. Flamand rossen, néerlandais afrossen « battre ».




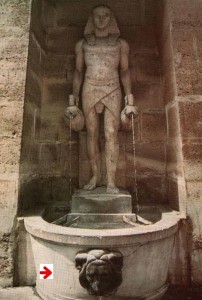





 aph
aph