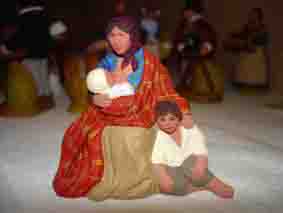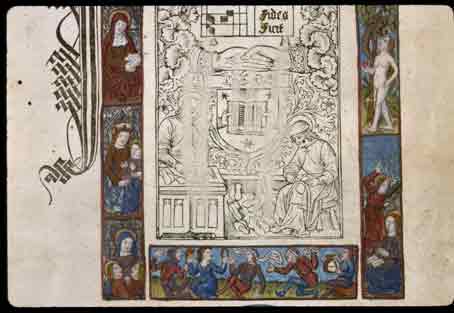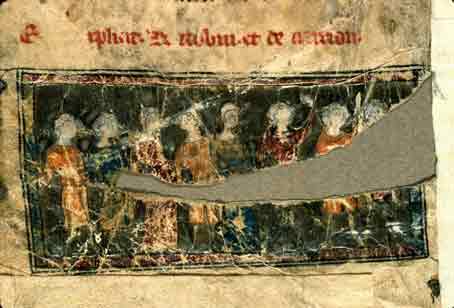Feda
Feda « brebis ».
Le latin avait un substantif fetus ou fœtus « enfantement » et un adjectif fetus « ensemencé, plein, gros ». Au féminin feta a pris le sens « qui a accouché » et substantivé « mère ». Ce sens s’est conservé en gascon hedo « femme qui vient d’accoucher », comme en italien feta et fetare « accoucher ». Feta a pris le sens spécifique de brebis déjà en latin; sens qui s’est maintenu en occitan, franco-provençal et dans certains patois en Italie.
Après le Moyen Age feta a été remplacé par les représentants de vervex (> brebis) dans le Nord-Est du galloroman. Pour les différends noms de la brebis en occitan voir le Thesocs.v. brebis
Uniquement en galloroman nous trouvons dérivé feto, fetonem avec le sens « petit d’un animal » faon en ancien français, sens qui se restreint à « petit de la biche » au XVe siècle (1re att. 1360 DMF). De là anglais fawn avec lez même sens. En occitan nous trouvons fedon, fedou(n) « poulain » mais aussi « agneau » et le verbe fedouna « mettre bas en parlant des juments et des ânesses ».