Blavet
Blavet « bleuet » est un dérivé du ancien franc *blao « bleu », cf. allemand blau, néerlandais blauw, ancien anglais blaw. 
Dans le Thesoc s.v. bleuet huit informateurs de l’Ariège ont donné comme mot local le type rossignol. Comment expliquer cela? La solution se trouve dans le FEW. L’enquêteur a dû demander « Comment appeler vous le bleuet ? » Ces informateurs ont compris qu’on leur demandait le nom d’un oiseau. En effet, dans quelques dictionnaires du XIXe siècle est mentionné: bleuet « martin-pêcheur » (Bescherelle 1845; voir aussi TLF).
Cette dénomination est typique pour certains parlers occitans : Nice bluiet, Aveyron, Tarn bluet. D’après les dictionnaires cités dans le FEW le bluè est dans le Gard la « mésange bleue », appelée blauet dans l’Hérault (M); dans les Bouches du Rhône le blavet est le « tarier, saxicola rubretra ».




martin-pêcheur mésange bleue tarier rossignol
D’autres noms du bleuet fleur : flor pèrsa (Charente); tartarièja° (Ardèche; Hte-Loire) le nom de la « rhimanthe crête de coq » (Alibert); escanapols (Saurat en Ariège; repris par Alibert). Il faudra demander à un paysan, s’il comprend le lien sémantique. Voir le verbe escanar.
Nous ne pouvons pas savoir si les types bluet, bleuet, blaveta dans le Thesoc correspondent à la fleur ou à l’oiseau.
Pour avoir une idée plus précise, j’ai consulté le RollandFaune. Pour le domaine occitan il nous donne les noms suivants: pêche-martin (Charente); bernard pescayre (Landes); aouzel de saint Martin; bluyet (Toulouse); martin pescaire (provençal); marti pescaire (languedocien); blabet (P.O); bluet (Tarn); blavié (Nice; languedocien); bluré (BduRh); bluret (provençal, languedocien); merle picheret (Limousin).
Le corps desséché de cet oiseau passe pour éloigner les mites et les teignes ; on s’en sert dans ce but dans un grand nombre d’endroits, de là les noms suivants qu’on lui donne : drapier s.m. (Isère); arnié s.m. (Languedoc ; Hérault, Provençal); arniè (Béziers); argné (Gard); Arné (PO); Darneire (Hte-Loire); Derna (Auvergne).
Remarque: Arnié, argné arné signifie proprement celui qui préserve des arnes = mites. Les mites s’appellent: Arna, arno prov.. Darno (Tarn ); Derna Auvergne, Arda (anc.occitan). Voir article Tinea dans le vol. III. de Rolland Faune.
Autre noms : Vable dé vilo (Gard); Alcyoun Languedocien.; Alussi Languedocien seulement dans la phrase cridà coumo un alussi » crier à tue tête.
Le « bleuet » (la fleur ou l’oiseau ??) est appelé escanapols à Saurat en Ariège; confirmé sans localisation par Alibert.
ATTENTION! Dans beaucoup de régions et notamment au Québec le bleuet est le nom de la myrtille! Le québecois est né des parlers des régions atlantiques, de la Normandie jusqu’à la Saintonge (BDP; FEW) et non pas du français parisien.



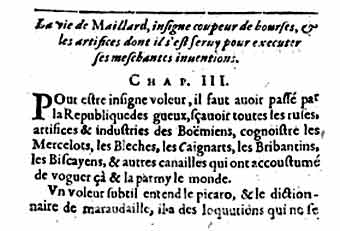
 le biou et le raseteur
le biou et le raseteur
