dailler ‘tacler’
dailler ‘tacler’, voir l’article dalio, dalià

Ce qui frappe en étudiant la répartition géographique de ces attestations est le fait qu’elles se trouvent sur une très grande étendue, des Cévennes jusqu’à St.Maximin et Hyères, avec une certaine concentration dans le triangle formé par Avignon, Nîmes et Arles. Le fait que brega est attesté à St.-André-de Valborgne, un village isolé des Cévennes, pourrait nous suggérer qu’il s’agit d’un mot fossile. Mais St.-Maximin et Hyères ne sont pas des lieux isolés.Pour en savoir plus, j’ai cherché le mot brego dans le Trésor de Mistral :
Dans les exemples et expressions qu’il fournit, on voit bien qu’ à la campagne c’est un outil, un brisoir de chanvre, sens qui a disparu avec la disparition de la culture du chanvre, en ville par contre le sens « bouche, mâchoire » est dominant.
dailler ‘tacler’, voir l’article dalio, dalià
Espargoule « pariétaire; asperge » vient d’un latin médiéval des botanistes spergula « plante du genre Galium« (?). Les botanistes du Moyen Âge, qui étaient en général médecins et pharmaciens, ont latinisé le mot provençal espargoulo un dérivé du latin asparagus « asperge ». Le nom espargoulo est limité au provençal + le département du Gard, attesté notamment à Saint-André de Valborgne. Voir Le FEW XXV, 464 pour les attestations, colonne à gauche, à partir de 2aα. En languedocien espargola, espargou(l) désigne « l’asperge » ! Attestations dans la même page, en bas à partir de 2aβ.
L’histoire de ce mot provençal se trouve à la page 466 et est rédigée en FRANÇAIS. Il suffit de cliquer sur le lien !
 pariétaire
pariétaire  pariétaire.
pariétaire.  asperge sauvage
asperge sauvage
Spergula a été adopté par Linné (1753) comme nom d’un genre de plantes herbacées de la famille des Caryophyllacées. (Wikipedia)
Ampouleto, ampouleta est le nom de la mâche (Valerianella locusta) dans le Gard, l’Hérault et la Lozère. L’étymologie est un croisement du latin pullus + ampula. (FEW IX,537).
Vous pouvez vous demander quel est le rapport entre une salade, une poule et une ampoule ou vase à large ventre ?
Or, dans les parlers franco-provençaux et quelques parlers occitans la mâche s’appelle grasso poulo ou poulay grasse. Ce nom est même mentionné dans l’Encyclopédie de Diderot et le premier Larousse poule grasse.
Mario Rossi donne une réponse dans son Dictionnaire étymologique et ethnologique des parlers brionnais : bourgogne du sud. 2 juin 2004., hélas sans nous fournir sa source. Il écrit qu’à l’origine la poule grasse est la lampsane1 :
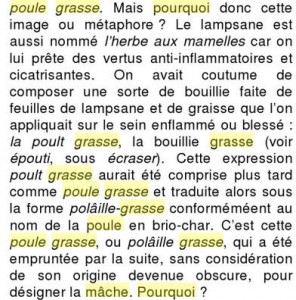 Cette histoire de poult me semble peu convaincante. Un premier problème est posé par le fait que pou, pous rarement poul du latin pŭls « bouillie » est en général masculin, ce qui aurait donné *le pous gras. Secondo, dans les dérivés c’est un –t- qui apparait et non pas un -l-: par exemple potie « grain de poussière », Barcelonnette poutilhas « bouillie de farine », occitan poutigno « chassie ». Voir pour beaucoup d’exemples le FEW IX, 549 et suivantes. Enfin la lapsana s’appelle Gallina grassa ou Erba delle mammelle en italien; il est donc très probable que poule grasse est une simple traduction du nom latin ou italien.
Cette histoire de poult me semble peu convaincante. Un premier problème est posé par le fait que pou, pous rarement poul du latin pŭls « bouillie » est en général masculin, ce qui aurait donné *le pous gras. Secondo, dans les dérivés c’est un –t- qui apparait et non pas un -l-: par exemple potie « grain de poussière », Barcelonnette poutilhas « bouillie de farine », occitan poutigno « chassie ». Voir pour beaucoup d’exemples le FEW IX, 549 et suivantes. Enfin la lapsana s’appelle Gallina grassa ou Erba delle mammelle en italien; il est donc très probable que poule grasse est une simple traduction du nom latin ou italien.
Déjà le Lozérien Guy de Chauliac (1298-1368) parle de gallina grassa qui entre dans la composition de l’ onguent verd des herbes qu’il recommande à mettre sur de vieilles playes. (Dans la Grande chirurgie de Guy de Chauliac p,677.La recette se trouve à la p.617-618. ) Il est donc possible qu’il ait simplement traduit le nom régional en latin, mais je pense que c’est plutôt l’inverse.. ( Cf. RollandFlore 6,p.294, que vous pouvez consulter dans le site de Plantnet ). D’après l’éditeur du texte de Guy de Chauliac il existe dans la bibliothèque du Vatican un manuscrit du Moyen Âge avec la traduction en provençal. Il serait intéressant de savoir comment le latin gallina grassa a été traduit.
La lampsana et la mâche ont ceci en commun que les feuilles se mangent en salade, ce qui explique le transfert du nom poule grasse.
L’étymologie populaire est un procédé analogique par lequel le sujet parlant rattache spontanément et à tort un terme ou une expression dont la forme et le sens sont pour lui opaques à un autre terme ou expression mieux compris par lui, mais sans rapport.
Voir FEW IX,537
Trenaire « tresseur » un mot occitan et franco-provençal, est dérivé de l’ancien occitan trena « tresse, chaîne tressée ». Les formes occitanes, arpitanes, catalanes et autres ibéro-romanes1 avec -e- obligent à supposer une étymologie *trĭnus avec un –ĭ– court, inexpliqué, tandis que l’italien trina vient du latin trīnus ‘triple, trois fois » avec un –ī– long.
Henri Bel écrit « Lou poulit trenayre de deskos »
ShareHenry Bel, dont j’ai déterré l’étude de phonétique historique sur le patois de Valleraugue, s’est lancé aussi dans la traduction de Mireio de Frédéric Mistral. Je n’en ai retrouvé que trois groupes du Chant 5. Voici les premiers vers:
Mistral:
Un vèspre dounc, en la Crau vasto,
Lou bèu trenaire de banasto
A l’endavans d’Ourrias venié dins lou droiòu.
Henri Bel
Un vèspre doun, din lo Kràw basto
Lou poulit trenayre de deskos
Ol doban d’Ourrias benyò din lou koroyrou.
Traduction
Un soir donc, dans la vaste Crau,
le beau tresseur de bannes,
à la rencontre d’Ourrias, venait dans le sentier.
Henri Bel a adopté non seulement une graphie qui lui permettait de bien rendre la prononciation locale, mais aussi un vocabulaire différent de celui de Mistral, dont
« grande corbeille ronde; panier rond; personne à la démarche lourde et gauche »(desca Alibert).
Etymologie: latin discus emprunté au grec δίσκος « disque à lancer ». Le mot avait déjà pris le sens « assiette, plat » chez les Grecs au premier siècle. Discus chez les Romains est un palet en pierre ou en fer, un plat ou un plateau ou un cadran solaire. Dans la langue latine écrite un palet ou un disque s’appelle orbis, mais dans la langue parlée, l’origine des langues romanes, c’est plutôt discu.
Le sens « disque à lancer » s’est perdu avec la pratique de ce sport à la fin de l’empire romain.
Les langues germaniques et celtiques ont adopté très tôt discus avec le sens « grand plat rond ».
Nous le retrouvons en breton disk, en anglais dish « plat, vaisselle », en danois disk « assiette », mais curieusement pas dans les langues romanes à quelques exceptions près. Ensuite discu prend le sens « table » comme en allemand Tisch et néerlandais dis « table », opdissen « mettre sur la table » 1, ce qui s’explique par le fait que les Germains mangeaient souvent avec des petites tables individuelles. Tacite 2 écrit « separatae singulis sedes et sui cuique mensa« (pour tous une chaise séparée et sa propre table) .
Les premières attestations de discu devenu deis en ancien français et des(c) en ancien occitan désignent une « (grande) table« , mais elles sont plutôt rares.
Le mot deis désigne par la suite aussi le « pavillon qui surmonte une table seigneuriale, puis aussi un lit un trône, un autel, ou qui est porté au-dessus du Saint Sacrément dans les processions. L’ancien occitan dèi est un « dais d’église ».
Comme le sens « disque » de des(c) avait disparu depuis longtemps, il faut supposer que le sens « grande corbeille » s’est développé en occitan à partir du sens « table ». Il a du s’agir d’abord de grands paniers ronds et peu profonds.
L’ancien occitan disc« panier » est encore utilisé à Lézignan, Béziers, et quelques autres endroits. Le dérivé desca, desco est plus répandu.
Un lecteur italien m’informe : « En Italien, on trouve le mot masculin « desco » ( = « table »). On l’ultilise que dans la poésie.« . Merci !
Acuchar « charger (le foin) » vient probablement du gaulois *kūkka que nous retrouvons dans les parlers du sud-est, en franco-provençal avec le sens « cime » et en provençal avec le sens « tas ». Voir FEW II, 1491. Il n’est pas clair si les deux significations existaient déjà en gaulois?
En ancien provençal est attesté cucho « tas de paille », en provençal moderne au Queyras cucho « tas, tas de bois qu’on met dans le four ».
Le verbe acuchar « entasser, amonceler » se trouve dans les parlers de l’Est, du francontois jusque dans le Var.
A Die on dit acucha lo ben! en offrant du vin (Han Schook). Claudette Germi, Les mots de Gap écrit « entasser; charger au maximum (un véhicule) ». Le verbe acucher est encore très vivant à la campagne.
 Étymologie:*kukka (gaulois) « cime » FEW II, 1491
Étymologie:*kukka (gaulois) « cime » FEW II, 1491
Le chemin du Couladou à Manduel se trouve à la sortie du village direction Bouillargues.
 Le début du chemin se trouve de l’autre côté du fossé et c’est une impasse.
Le début du chemin se trouve de l’autre côté du fossé et c’est une impasse.
Étymologie : Couladou est un dérivé du latin cōlare « filtrer, épurer ». Le verbe ancien occitan colar signifie « faire passer un liquide (surtout le lait) à travers un filtre »; de nos jours c’est devenu « filtrer » tout court. Voir FEW II, 877 ss
Dans l’article de Chantai Lombard intitulé LES TARAIETTES, JOUETS POPULAIRES DE PROVENCE MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE. j’ai trouvé le mot couladou dans la définition de taraiette : « Pour filtrer – filtre à eau, couladou » (paragraphe 9 ). Voir aussi taraietto
Il semble peu probable que le chemin du Couladou à Manduel doive son nom à un jouet, mais je pense qu’il y a (eu) une station d’épuration d’eau ou un filtrage d’un autre liquide, du vin peut-être? Mon informant principal pour le parler de Manduel m’écrit qu’il y avait un tout petit ruisseau à cet endroit qui a pu servir pour la lessive. . Il y a en effet un trait bleu sur la carte Google.
D’après Google ce chemin se trouve à la sortie du village direction Bouillargues.
Je dois encore aller faire une photo. Il n’y a pas de ruisseau, ni de station.
Mistral nous donne les sens suivants
1. Ce qui coule en une seule fois; éboulis, avalanche.
2. Bout de linge qu’on met dans le trou du cuvier pour conduire l’écoulement de la lessive.
3. Panier qui sert à filtrer le vin.
4. Ustensile qui soutient l’étamine pour couler le lait.
5. Couloir, filtre, crible.
6. Cordon ombilical.
Mon informant pour Manduel m’écrit qu’il y avait un tout petit ruisseau à cet endroit qui a pu servir pour la lessive. . Il y a en effet un trait bleu sur la carte Google.
Braietos, braïettes en français rég. ‘primevère », à Valleraugue (Gard) « narcisse des prés ». L’étymologie est le celte braca » pantalon ». Cette formulation est un bon exemple d’une étymologie de dictionnaire qui nous apprend rien. Par contre l‘histoire de ce mot qui nous vient de loin, nous renseigne entre autres sur l’évolution de l’habillement, bref de la Mode. (FEW I,482)
Les Romains n’ont jamais eu l’idée de couvrir les jambes avec du tissu, à Rome il faisait trop chaud pour cela. En conquérant la Gaule, où régnait un autre climat, les centurions, jambes nues, voyaient les Astérix et Obélix avec des bracae qui couvraient les jambes jusqu’aux chevilles. Malins, ces Gaulois!
Les centurions les ont certainement vite adoptées, en dehors des combats bien sûr, et parfois ils les portaient quand ils revenaient de la Gaule passer leur permission. A Rome c’était considéré barbare et ridicule. Au premier siècle on les montrait encore du doigt, mais on n’osait quand-même pas trop se moquer de ces soldats. Deux siècles plus tard tout le monde portait des bracae.
C’est comparable à l’histoire du jean en denim.
La Mode s’en est occupée et le pantalon gaulois, très long, a été de plus en plus raccourci. Au temps des Mérovingiens on portait un genre de « short’ qui couvrait les cuisses qu’on appelait chausses:
 Ensuite au cours du Moyen Âge les chausses ‘s’allongent et couvrent les braies, qui changent de « classe sociale » et deviennent « caleçon, culotte, pantalon de travail, langes », bref, un vêtement qu’on ne montre pas ou peu.
Ensuite au cours du Moyen Âge les chausses ‘s’allongent et couvrent les braies, qui changent de « classe sociale » et deviennent « caleçon, culotte, pantalon de travail, langes », bref, un vêtement qu’on ne montre pas ou peu.
Avant que les braies disparaissent de la vue et de la rue, on a comparé la fleur de la primevère à la jambe d’une braie :
Déjà au Xe siècle nom coculobraca se trouve dans une liste de plantes en latin, une combinaison de cŭcūlus + bracae, littéralement « braies de coucou » ou « braies de niais ». S’agit-il d’un souvenir que la braie n’était pas « classe »? En occitan braguet signifie aussi « canon de culotte.
Par abréviation braies de coucou ou coucu devient braies, braiettes, ou bien coucüt, coouguioulo etc1 un peu partout en France. D’après le Thesoc le type coucu est le plus répandu.
La primevère et la narcisse des prés ont deux traits en commun : elles fleurissent au printemps et elles sont jaunes. Cela suffit pour un transfert du nom. Par exemple à Saint-André de Valborgne, comme dans l’Aveyron et ailleurs (voir FEW II, 1454b) coucüt désigne aussi la « narcisse des prés ». A Valleraugue c’est l’inverse ce sont des braiettes.
Dans plusieurs parlers du Nord et dans les Ardennes le coucou/cocu a été remplacé par le chat : braille de chat à Maubeuge Ailleurs braies a été remplacé par chausses; toujours dans l’Aveyron la primevère est aussi appelée calsos de coucüt. 2
PS. Le Thesoc fournit 4 autres noms pour la narcisse des prés: coutèlo , courbadona, barbeluda et aneda.