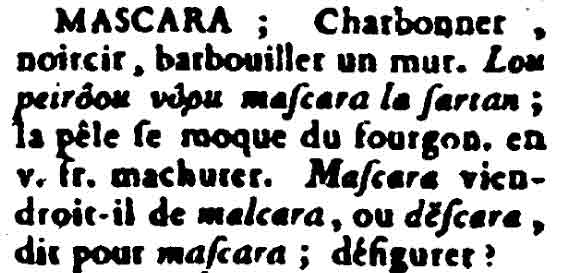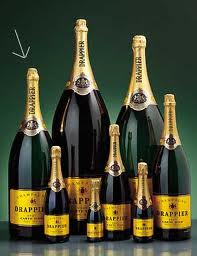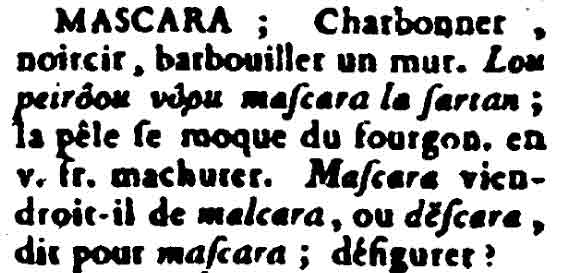

comme Séguier1 qui donne même la conjugaison: est tout mascara; s’est masacara; l’ant mascara; vous masquarevez). Le verbe est courant en occitan et il est resté vivant en français régional. D’après Domergue dans les arènes de la Camargue quand les raseteurs sont mauvais et la course est décevante les spectateurs se font mascarer. En sortant ils disent : « Aujourd’hui on s’est bien fait mascarer » (noircir, machurer… avoir).
Un dicton donné par l’abbé a été noté à Pouzilhac (Gard) : lu piróu ké mascare la sartan à la fin du XIXe siècle. A Valleraugue (30570) Charles Atger a noté une variante: Lo podéno qué bol moscora lou cremal = le poêle qui veut noircir la crémaillère.
Mascara est un dérivé de mask- « noir » un mot qui est absent du latin et qui, pour des raisons phonétiques et/ou sémantiques ne peut être ni celtique ni germanique ou arabe. Par conséquence on suppose une origine pre-indo-européenne. La racine mask- est à l’origine de trois groupes de mots avec les sens :
-
1. sorcière, p.ex. à Alès : masquo « femme vieille, laid et méchante; fille espiègle »; en Auvergne masque « prostituée ». Marseille masco « papillon tête de mort, dont la venue est prise en mauvais augure ».
-
2. noircir avec de la suie, p.ex. anc. français maschier « feindre; cacher »; occitan mascoutá » cacher le défaut d’une marchandise »; Val d’Aran maskart (-arda) « nom d’une race bovine dont la tête est noire »; mascara « fard de cils » voir ci-dessous.
-
3. masque, p.ex. masque « fard »; masquer « cacher »; languedocien mascarado « troupe de gens déguisés et masqués »
L’ancien occitan masco « sorcière » est conservée dans beaucoup de parlers provençaux et languedociens p.ex. en Camargue subst. m. et f. « jeteur de sorts, sorcière » et à Béziers au fig. « nuage qui annonce la pluie »). En français régional être emmasqué veut dire « être victime d’une sorcière » (Lhubac). Le masculin masc «sorcier » existe également.
Dans un vieux texte de Narbonne (1233) nous trouvons le dérivé. mascotto « entremetteus ( ?), sortilège, ensorcellement au jeu » qui a donné en français mascotte. Les dérivés avec le sens de « sorcier, ensorceler » etc. sont innombrables, ainsi que les mots avec le sens « noircir, barbouiller », comme p.ex. mascara verbe n. et s., par-ci par-là machura, matchura.
Mascara s.m. « fard de cils ». Dans Wikipedia l’histoire du mascara est décrite comme suit :
Le mascara moderne a été inventé en 1913 par un chimiste appelé T. L. Williams pour sa sœur, Maybel. Ce premier mascara était fait de poussière de charbon mélangée à de la vaseline. Williams vend son produit par correspondance et crée une société qu’il appelle Maybelline, combinaison du nom de sa sœur Maybel et de vaseline. Maybelline est aujourd’hui une importante société de cosmétiques appartenant au groupe L’Oréal. Le mascara n’était disponible que sous forme de pain, et était composé de colorants et de cire de carnauba. Les utilisatrices mouillaient une brosse, la frottaient sur le pain de mascara puis l’appliquaient sur les yeux. La version actuelle comprenant un tube et une brosse a été présentée en 1957 par Helena Rubinstein.
Williams a peut -être passé des vacances en Allemagne, où un certain Eugène Rimmel a crée en 1834 un produit cosmétique permettant de surligner les yeux en colorant les cils et leur donnant plus de longueur apparente. En allemand le mascara s’appelle Rimmel ®.
Le sens du mot mascara « fard de cils » a donc été crée par T.L. Williams et ce sens a été emprunté par le français à l’anglais. Ce qu’il faudrait savoir où Williams l’a trouvé. Les étymologistes anglais ainsi que le TLF lui donnent une origine espagnole où màscara signifie « masque » et non pas « fard de cils ». Mme H.Walter lui attribue une origine italienne, sans dire pourquoi. Le dictionnaire espagnol de la Real academia española (voir Lexilogos), lui attibue également une origine italienne maschera qui l’aurait emprunté à l’arabe mas·arah « objet de risée ». Pour compléter ces résultats, je trouve dans un dictionnaire italien : » mascara sm. inv. [sec. XX; dall’inglese mascara, risalente allo sp. máscara, maschera]. Cosmetico per ciglia,…. » . Nous tournons en rond.
 Williams a peut-être aussi passé des vacances en pays d’Oc. En le renseignat sur la météo son hôte lui a dit « Le ciel se mascare! » Vu sa forte présence dans tous les parlers d’oc je propose donc une origine occitane, où mascara a exactement le sens qu’il faut « noircir »…? J’ai écrit à Maybelline NY qui a racheté l’entreprise de T.L.Williams., pour une confirmation. J’ai attendu longtemps une réponse, qui n’est jamais arrivée. La maison m’a envoyé de la publicité!!
Williams a peut-être aussi passé des vacances en pays d’Oc. En le renseignat sur la météo son hôte lui a dit « Le ciel se mascare! » Vu sa forte présence dans tous les parlers d’oc je propose donc une origine occitane, où mascara a exactement le sens qu’il faut « noircir »…? J’ai écrit à Maybelline NY qui a racheté l’entreprise de T.L.Williams., pour une confirmation. J’ai attendu longtemps une réponse, qui n’est jamais arrivée. La maison m’a envoyé de la publicité!!
Je crois avoir convaincu Douglas Harper qui suit cette proposition dans son site et cite le FEW von Wartburg! .s.v. mask. Pour ça, je suis content.
Dans l’argot des catcheurs/lutteurs mascara signifie « cagoulard (cf P.Perret « Le parler des métiers« ) sens qui se rapproche de l’italien ou de l’espagnol.
Le sens « masque » de masquo (déjà S) est un emprunt à l’italien maschero, du XVIe s. mais la forme masquo existait depuis longtemps. L e nom Mascator est attesté à Arles en 520, et vit toujours en Languedoc : autrefois Mascaire et avec une graphie francisée Maquere. Si vous vous appelez ainsi, s.v.p. ecrivez-moi!. Dans l’ Hommage du château de Saint-Martial (Gard) à l’évêque de Nîmes de mars 1179. est nommé un Petro Mascharono archidiacono..


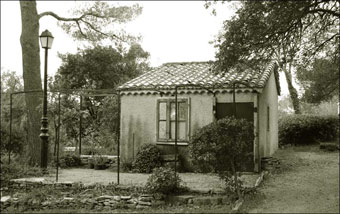

 panis +caseus
panis +caseus