

Mène « manche dans une partie de jeu de boules ». René Domergue Avise, la pétanque! donne une définition très précise :
Une mène : temps entre le lancer du petit et le lancer de la dernière boule (plusieurs mènes dans une partie).
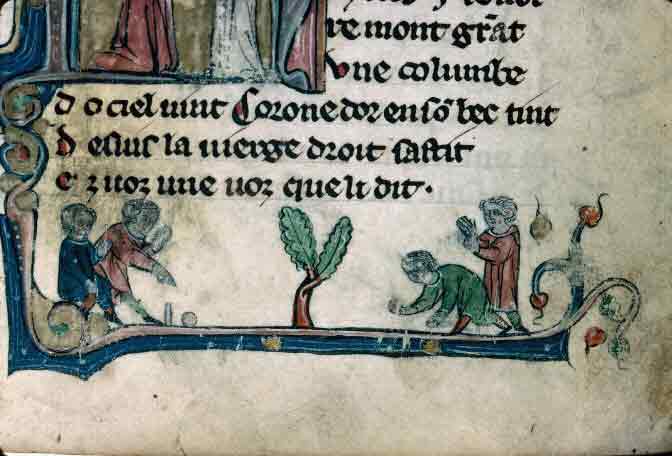
En dehors du milieu bouliste et des joueurs à la belote le mot doit être rare. Même Google ne donne que très peu d’exemples.
Dans les dictionnaires de l’occitan il y a plusieurs mots mèna, mène, mais aucune signification qui s’approche de « manche dans un jeu »1.
Elle cite le travail de Gaston Tuaillon 3 qui a donné la définition suivante pour le mot mène dans le parler franco-provençal de Vourey (Isère)
Un aller (ou un retour) dans un travail comme les labours ou dans un jeu comme le jeu de boules où l’on ne cesse d’aller et de venir ».
La première attestation de ce sens en ancien occitan est mena « manière d’être » ( XIIe-XIIIe s.), qu’on retrouve en italien, chez Dante mena « condition, sorte ». En occitan moderne, c’est l’expression de bouono meno « de bonne qualité » qui domine.
L’étymologie serait alors le verbe menar « mener, conduire, accompagner, exploiter un domaine agricole » du latin minare « conduire ». Un dérivé de menar, menada signifie « ce qu’on mène en une seule fois; quantité d’olives qu’on détrite en une fois » (Alibert). Le même sens est aussi attesté pour le mot voyage (Mistral, Champsaur)
Je crois avoir trouvé une autre explication de l’évolution sémantique que celle proposée par G.Tuaillon. Je pense que le passage du mot mèno dans le milieu bouliste, est parti de l’expression de bouono meno . L’équipe qui a gagné « a fait un jeu de bouono meno, et pour ne pas vexer l’équipe adversaire, il faut admettre qu’eux aussi ont fait une bouono meno. Une mène est par conséquent toujours bouona.
___________________________________
Bonjour,
Ce mot est un déverbal de « mener » dans l’expression « mener le but », c’est à dire lancer le but et pointer la première boule, au début de la partie et de chaque manche ultérieure, quand les joueurs ont épuisé toutes leurs boules. Cette expression est encore utilisée à la pétanque : « mener le bouchon, le cochonnet ».
L’usage de ce verbe dans ce sens particulier est d’origine lyonnaise.
Voici quelques citations anciennes :
– « Puis, le but à la main, jeté par Bien-Approche, / Ce célèbre pointeur que jamais rien accroche, / Du courageux Bayard, imitant les vertus, / Sans peur et sans reproche quand il mène le but […] » (« Pochade sur une partie de boules dite grattée », L. Bourgeon, Lyon, 1874)
– « Pointeur excellent, il mène généralement le but, en d’autres termes joue le premier ; bien rare est-il si ses deux boules n’en font pas passer 4 à 5 de celles de ses adversaires. » (idem, 13 août 1893)
Le premier pointeur, à Lyon, était appelé « meneur de but » quand on mettait l’accent sur cette responsabilité importante pour le déroulement de la partie (choix d’un jeu plus ou moins long selon les qualités des joueurs en présence) :
– « Les meneurs de but s’appliquaient généralement à faire des jeux longs ou courts, suivant les instructions de leur tireur. S’ils manquaient leurs combinaisons dès le premier lancement, ils avaient six chances sur dix de la réussir au deuxième jet de but. » (« Chronique des boules », Le Progrès Illustré, Lyon, 31 mars 1901)
Le déverbal « mène », en revanche, n’est pas d’origine lyonnaise mais provençale et plus précisément varoise ; à Lyon, les manches étaient appelées « jet (de but) » ou « jetée (de but) » : « à la troisième jetée de but… », « partie gagnée en 5 jets », etc.
L’attestation la plus ancienne du substantif que j’aie retrouvée est toulonnaise et remonte à 1906. L’emprunt de ce verbe peut s’expliquer par la participation précoce de quadrettes toulonnaises, dont celle des célèbres Prébois et Parpelet, à certains grands concours de boule lyonnaise à partir de l’extrême fin des années 1890.
Les manches étaient appelées « menées » ou, beaucoup plus souvent, « mènes » :
– « Cette partie débute en favorisant la série 19, qui inscrit 3 points, mais cette dernière n’en marquera plus qu’un d’ici à la fin de la partie, car la série 12 a un tireur remarquable qui se joue du but et qui en cinq « menées » seulement triomphera rapidement de ses adversaires. » (« Notre concours de boules », La République du Var, Toulon, 10 septembre 1906)
– « A la 8e « mène », la quadrette Prébois termine brillamment la partie du matin par un coup de but qui lui vaut 3 points. » (idem, 10 septembre 1906).
L’introduction du mot à Marseille s’est effectuée aux environs de 1912, date apparente de sa première attestation dans la presse phocéenne :
– « Après avoir marqué à la première « mène » six points, les redoutables Toulonnais l’emportaient facilement à la septième partie, laissant leurs adversaires à deux points. » (« Notre concours de boules », Le Petit Provençal, 10 septembre 1912)
Ce n’est pas le seul exemple d’emprunt ou dérivation réciproque dans le vocabulaire technique et jargonnesque ancien du jeu de boules entre le Lyonnais, la Provence et aussi le Dauphiné, certains emprunts d’origine majoritairement provençale remontant même à la deuxième moitié du XIXème siècle. Par exemple les mots « donnée » (« dounado »), « demi-donnée », « refente », « téter (le but, le petit) » au XIXème siècle, « boulodrome », « quadrette / triplette / doublette », « carreau », « gratton » etc. (Lyon et région lyonnaise, années 1890) au XXème.
Laurent
BONNE EXPLICATION!!!
RESPECT!!!
ci joint UN NOUVEAU JEU LA PORTANQUE!!!!
n’hésitez pas à me rappeler au 07 87 41 64 66.
pour plus d’informations
A propos de l’origine du mot « manche » : elle est médiévale. Au moyen âge les dames portaient des manches amovibles sur leurs robes. Lors des tournois, les chevaliers recevaient une manchede la dame dont ils défendaient les couleurs. Une manche correspondait à une série d’affrontements.